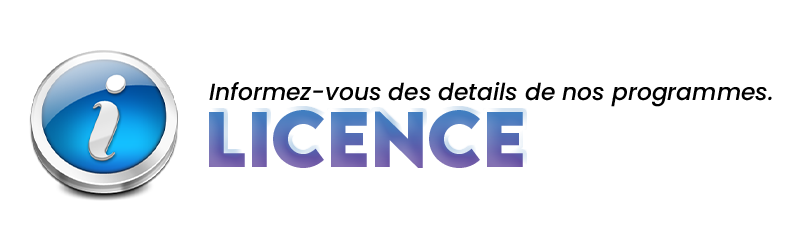
Notre mission est ancrée dans l'excellence académique, l'intégrité, l'éthique et l'engagement communautaire. Nous voulons que nos étudiants comprennent l'importance de la responsabilité sociale et de la citoyenneté active.
Notre vision est de devenir le fer de lance de l'éducation et de la recherche en Haïti, en formant la prochaine génération de décideurs, de chercheurs et de citoyens engagés qui contribueront au développement durable de notre pays.
Notre Objectif
S'engager à offrir des programmes éducatifs de la plus haute qualité, à encourager la recherche pertinente dans nos domaines d'expertise, à promouvoir l'engagement communautaire, à collaborer avec d'autres institutions.
Articles
 OpinionPublié le: 16-Oct-2025
OpinionPublié le: 16-Oct-2025
Écoles publiques haïtiennes: entre gouvernance défaillante et stigmates sociaux
Par : Orel Stheker VINCENT Diplômé en Gouvernance Locale Dans l’imaginaire collectif haïtien, l’école représente le levier par excellence de l’ascension sociale pour celles et ceux issus des milieux les plus modestes. Il n’est pas nécessaire de citer des noms pour se faire rapidement une idée de cette réalité. Bien qu’elle soit le déclencheur d’une transformation individuelle et, par extension, qu’elle contribue positivement à la vie sociale, l’école demeure souvent une impasse où seuls les meilleurs ou les plus chanceux réussissent à s’en sortir. Peut-on véritablement bâtir un système scolaire sur ces deux extrémités alors que l’école est censée être un espace de transformation individuelle et de cohésion collective, formant des citoyens responsables et engagés ? Comprendre le système « antonwa » de nos écoles revient à saisir la réalité du secteur éducatif national, marqué par la ségrégation et des rapports sociaux inégalitaires, comme l’a souligné le Docteur Jacques Abraham. Selon lui, les écarts entre les différentes écoles et les disparités sociales sont tels qu’ils engendrent des individus parfois étrangers à eux-mêmes et incapables de contribuer de manière significative au développement de leur pays. Dans le paysage éducatif haïtien, les écarts entre les écoles publiques et non publiques sont une évidence. Toutefois, au sein même des écoles publiques se cache une triste réalité même si elles incarnent à la fois l’espoir d’une éducation accessible et les limites d’un système en tension. À travers une étude comparative entre l’École Communale et Municipale de Pétion-Ville (ECMPV) et l’École Nationale du Guatemala (ENG), nous avons pu constater les disparités structurelles, administratives et sociales qui affectent la qualité de l’enseignement et la perception des gens de la communauté à l’égard de ces établissements publics. Ces deux écoles, bien que situées dans la même commune, illustrent deux modèles de gouvernance distincts: l’un sous tutelle de la municipalité, l’autre sous contrôle de l’État central via le Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle. Cette dualité révèle les failles d’un système éducatif fragmenté, où les enjeux de financement, de stabilité administrative et de reconnaissance sociale se conjuguent pour façonner des trajectoires scolaires inégalitaires. L’analyse organisationnelle montre que l’ENG bénéficie d’un encadrement plus structuré, avec un personnel enseignant régulier et fonctionnaire de l’État central, des infrastructures relativement solides et une certaine régularité dans la gestion pédagogique. En revanche, l’ECMPV souffre d’une surcharge des effectifs bien plus grande que l’ENG, d’un environnement physique dégradé et d’une instabilité chronique du personnel enseignant, souvent nommé selon des logiques politiques locales. Cette précarité administrative, couplée à des salaires irréguliers (soit 10000.00 gourdes par trimestre) et à l’absence d’avantages sociaux, engendre une démotivation généralisée et compromet la continuité pédagogique. L’écart entre les deux établissements ne réside pas uniquement dans les ressources disponibles, mais dans la capacité des structures de gouvernance à assurer une gestion cohérente et équitable. Le concept de gouvernance éducative est central. Il ne s’agit pas seulement de gérer des ressources, mais de construire une vision partagée de l’école publique comme levier de développement local. Or, cette vision est souvent absente dans les écoles communales, où la planification est soumise aux aléas politiques et aux limites budgétaires des municipalités. À l’inverse, les écoles nationales, bien que confrontées à leurs propres défis, bénéficient d’une certaine stabilité institutionnelle. Cette asymétrie pose la question de l’autonomie des collectivités territoriales dans la gestion éducative et de leur capacité à mobiliser les acteurs locaux autour d’un projet scolaire durable. La perception sociale des écoles publiques constitue un autre axe majeur de l’étude. Les entretiens menés auprès des élèves et des familles révèlent une image souvent négative des établissements publics, perçus comme des lieux de relégation sociale. Le mépris institutionnel dont ils font l’objet se traduit par une faible valorisation des enseignants, une stigmatisation des élèves et une reproduction des inégalités. Les stéréotypes associés à l’école publique – manque d’enseignants qualifiés dans l’ECMPV, infrastructures délabrées de l’ECMPV– alimentent un cercle vicieux où la démotivation scolaire devient une conséquence autant qu’un symptôme. Cette perception sociale, loin d’être anodine, influence directement les parcours éducatifs et les aspirations des jeunes. Face à ces constats, nous proposons des pistes concrètes pour améliorer la gouvernance et l’image des écoles publiques. Il s’agit notamment de renforcer l’autonomie administrative des établissements, de diversifier les sources de financement, de mettre en place des mécanismes de reddition de comptes et d’impliquer les communautés locales dans la gestion de l’école. Des actions de sensibilisation sont également nécessaires pour revaloriser l’école publique dans l’imaginaire collectif. Ces recommandations ne visent pas seulement à corriger des dysfonctionnements, mais à réhabiliter l’école comme espace de citoyenneté, d’émancipation et de cohésion sociale. En définitive, cette étude souligne que la qualité de l’éducation publique ne dépend pas uniquement des moyens financiers, mais de la volonté politique et de l’engagement communautaire. L’école, en tant qu’institution centrale de la société, mérite une gouvernance transparente, inclusive et ambitieuse. La commune de Pétion-Ville, bien que confrontés à des réalités différentes dans les deux écoles, illustrent les défis communs d’un système éducatif en quête de sens et de justice. Pour que l’école publique devienne un véritable moteur de transformation sociale, elle doit être pensée comme un bien commun, porté par tous et pour tous.
Lire plus BlogPublié le: 03-Oct-2025
BlogPublié le: 03-Oct-2025
Roland Joseph s’adresse au Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU sur la crise en Haïti
Conseil des Droits de l’Homme – 60ᵉ session | Point 10 : Haïti Intervention de Roland Joseph, Genève, 2 octobre 2025 Cet article est rédigé par l'équipe du Caribbean Center for Nonkilling , Peace and Conflict Studies (CCNPCS) L’Institut de Gestion, de Gouvernance et d’Études Politiques (IGGEP) et le Caribbean Center for Nonkilling, Peace, and Conflict Studies (CCNPCS), fondé par Roland Joseph et travaillant de concert avec le Center for Global Nonkilling (CGNK), une organisation internationale à but non lucratif bénéficiant d’un statut consultatif auprès de l’ONU, sont fiers de partager l’intervention du Dr Roland Joseph lors de la 60ᵉ session du Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies, portant sur la situation urgente en Haïti (Point 10). Cette intervention a été facilitée et coordonnée par Christophe Barbey, représentant principal du CGNK à Genève, et s’est déroulée en présence de plusieurs diplomates ainsi que de représentants d’autres organisations internationales et ONG. Dans son intervention, Dr. Joseph a souligné l’impact dramatique des gangs armés sur la population, qui terrorisent la capitale, en contrôlant près de 90 % de celle-ci et en bloquant les routes reliant les dix départements du pays. « Récemment, plus de 40 personnes — femmes, enfants et personnes âgées — ont été massacrées dans la commune de Cabaret », a-t-il rapporté. Il a également insisté sur l’ampleur du déplacement forcé des familles haïtiennes. En juin 2025, environ 1,3 million de personnes avaient été déplacées en raison de la violence, dont plus de la moitié étaient des enfants. « Près d’un enfant sur six en Haïti est désormais déplacé, soit environ 700 000 enfants », a précisé Dr. Joseph. Alarmant, 30 à 50 % des membres des gangs sont eux-mêmes des enfants, illustrant la nature profonde et cyclique de cette crise. Dr. Joseph a attribué cette situation tragique à la violence structurelle, enracinée dans la pauvreté et l’injustice sociale. Il a appelé à des solutions allant au-delà des mesures sécuritaires immédiates, en prônant des approches basées sur les principes de non-meurtre, notamment à travers des programmes complets d’éducation à la paix dans les écoles et les communautés. « Nous exhortons le Conseil et la communauté internationale à soutenir ces efforts, afin de donner à Haïti une chance de retrouver la paix et la dignité », a-t-il conclu. Le CCNPCS continue de promouvoir les perspectives de non-meurtre comme des outils essentiels pour une paix durable, la protection des droits humains et le développement durable en Haiti et à travers le monde. Voir l’intervention complète sur UN Web TV : UN Web TV – 38ᵉ réunion, 60ᵉ session. Time exacte: 39:42-41:14. https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwebtv.un.org%2Fen%2Fasset%2Fk1z%2Fk1zd31r260&data=05%7C02%7C%7C6f05853ceb8944084f2208de02d170c3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638951295722428075%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=E%2B22q71xYEFMDEWHbd4cG%2B0MECwYB0XOsG4PozrUPn0%3D&reserved=0
Lire plus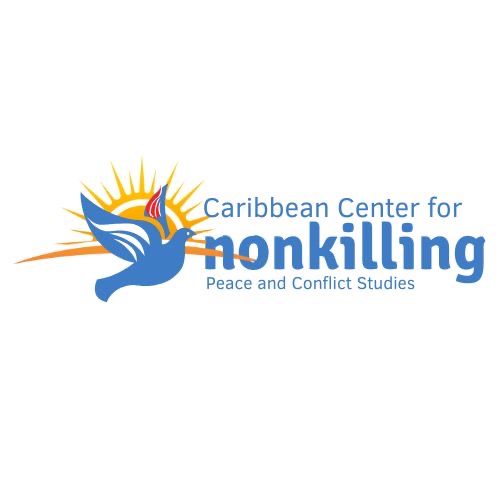 Communiqué Publié le: 22-Sep-2025
Communiqué Publié le: 22-Sep-2025
Forum virtuel sur la paix : les jeunes haïtiens engagés pour une société haitienne basée sur les principes du "nonkilling"
À l’occasion de la Journée internationale de la paix, le Caribbean Center for Nonkilling, Peace, and Conflict Studies (CCNPCS) de l'Institut de Gestion, de Gouvernance et D’Études Politiques (IGGEP) a organisé, le 21 septembre 2025, un forum virtuel via Zoom, retransmis en direct sur Facebook. Cet événement a réuni un large public, dont plusieurs jeunes et étudiants d’Haïti, autour d’un thème central : « Quelles actions entreprendre pour lutter contre la violence et le meurtre en Haïti et construire une société haïtienne de nonkilling » La rencontre a été marquée par la richesse des interventions de jeunes leaders communautaires et d’étudiants, dont beaucoup avaient participé récemment au séminaire d’initiation à la science politique nonkilling, organisé par le CCNPCS avec le soutien du Center for Global Nonkilling (CGNK). Les échanges ont largement porté sur la situation sécuritaire en Haïti, mettant en lumière l’urgence d’initiatives éducatives et citoyennes pour promouvoir une culture de paix. De nombreux intervenants ont plaidé en faveur de l’intégration de l’enseignement de la paix et du nonkilling dans les programmes de formation et dans la vie communautaire. En conclusion, Roland Joseph, président du CCNPCS, a donné rendez-vous aux participants pour le 2 octobre 2025, à l’occasion de la Journée internationale de la non-violence, pour poursuivre la réflexion et le dialogue sur les défis liés à la violence en Haïti. Il convient de rappeler que le CCNPCS est une structure récente, créée en Haïti au sein de l’Institut de Gestion, de Gouvernance et d’Études Politiques (IGGEP), en partenariat avec le Center for Global Nonkilling (CGNK).
Lire plusConseil d'Administration
FAQ
Nous offrons un accompagnement personnalisé à travers des services de tutorat, des stages encadrés, des ateliers de développement de compétences, et des partenariats avec le secteur privé. Nos programmes sont conçus pour répondre aux besoins du marché tout en cultivant l'esprit d'analyse et d'innovation.
L'université s'engage à créer un environnement inclusif où chaque étudiant, quel que soit son parcours, peut s'épanouir. Nous avons mis en place des bourses d'accès, des programmes de sensibilisation, et des structures d'écoute pour garantir l'équité et le respect de toutes les identités.
Nous recherchons des profils passionnés, compétents et engagés dans la transmission du savoir. L'excellence académique, la capacité à innover pédagogiquement, et l'ouverture à la collaboration interdisciplinaire sont des critères essentiels. Nous valorisons aussi l'expérience terrain et l'implication dans la communauté.
Notre vision est de renforcer notre position comme pôle d'excellence académique et d'innovation. Nous visons à moderniser nos infrastructures, élargir nos partenariats internationaux, et intégrer davantage les technologies numériques dans l'enseignement et la recherche. L'objectif est de former des citoyens compétents, critiques et engagés.
La recherche est au cœur de notre pédagogie. Dès la licence, les étudiants sont encouragés à participer à des projets de recherche, à des séminaires et à des publications. Cela développe leur esprit critique et leur capacité à résoudre des problèmes complexes de manière rigoureuse.
Abonnez-vous à notre newsletter
Espace recrutement
Envie de faire une vraie différence ? Rejoignez notre université et contribuez à former les esprits de demain. Nous vous offrons un cadre stimulant, une mission valorisante et une équipe engagée. Postulez dès maintenant et devenez acteur du changement.
Postuler pour un poste a l'IGGEP







